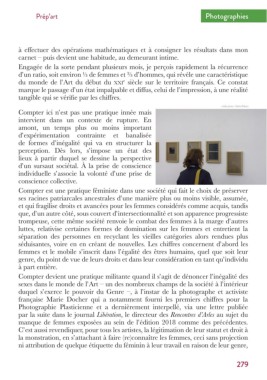Page 279 - Catalogue-livre_Rencontres Traverse 2019_L'Expérimental-recherche-art
P. 279
Prép’art Photographies
à effectuer des opérations mathématiques et à consigner les résultats dans mon
carnet – puis devient une habitude, au demeurant intime.
Engagée de la sorte pendant plusieurs mois, je perçois rapidement la récurrence
d’un ratio, soit environ ⅓ de femmes et ⅔ d’hommes, qui révèle une caractéristique
du monde de l’Art du début du xxie siècle sur le territoire français. Ce constat
marque le passage d’un état impalpable et diffus, celui de l’impression, à une réalité
tangible qui se vérifie par les chiffres.
Compter ici n’est pas une pratique innée mais crédit photo : Kaëlis Robert
intervient dans un contexte de rupture. En
amont, un temps plus ou moins important
d’expérimentation contrainte et banalisée
de formes d’inégalité qui va en structurer la
perception. Dès lors, s’impose un état des
lieux à partir duquel se dessine la perspective
d’un sursaut sociétal. À la prise de conscience
individuelle s’associe la volonté d’une prise de
conscience collective.
Compter est une pratique féministe dans une société qui fait le choix de préserver
ses racines patriarcales ancestrales d’une manière plus ou moins visible, assumée,
et qui fragilise droits et avancées pour les femmes considérés comme acquis, tandis
que, d’un autre côté, sous couvert d’intersectionnalité et son apparence progressiste
trompeuse, cette même société renvoie le combat des femmes à la marge d’autres
luttes, relativise certaines formes de domination sur les femmes et entretient la
séparation des personnes en recyclant les vieilles catégories alors rendues plus
séduisantes, voire en en créant de nouvelles. Les chiffres concernent d’abord les
femmes et le mobile s’inscrit dans l’égalité des êtres humains, quel que soit leur
genre, du point de vue de leurs droits et dans leur considération en tant qu’individu
à part entière.
Compter devient une pratique militante quand il s’agit de dénoncer l’inégalité des
sexes dans le monde de l’Art – un des nombreux champs de la société à l’intérieur
duquel s’exerce le pouvoir du Genre –, à l’instar de la photographe et activiste
française Marie Docher qui a notamment fourni les premiers chiffres pour la
Photographie Plasticienne et a dernièrement interpellé, via une lettre publiée
par la suite dans le journal Libération, le directeur des Rencontres d’Arles au sujet du
manque de femmes exposées au sein de l’édition 2018 comme des précédentes.
C’est aussi revendiquer, pour tous les artistes, la légitimation de leur statut et droit à
la monstration, en s’attachant à faire (re)connaître les femmes, ceci sans projection
ni attribution de quelque étiquette du féminin à leur travail en raison de leur genre,
279