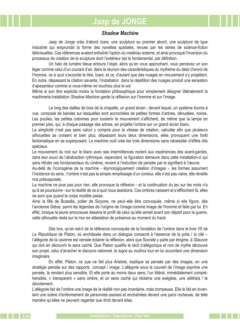Page 136 - catalogue_2012
P. 136
Jaap de JONGE
Shadow Machine
Jaap de Jonge créa d’abord Icare, une sculpture au premier abord, une sculpture de type
industriel qui empruntait la forme des navettes spatiales, revues par les séries de science-fiction
télévisuelles. Ces références avaient entraîné l’option du matériau externe, et ainsi provoqué l’inversion du
processus de création de la sculpture dont l’extérieur est le fondamental, par définition.
Un halo de lumière bleue entoure l’objet, alors qu’en vous approchant, vous percevez un son
léger comme celui d’un courant d’air, dans la réunion des caractéristiques du mythème du désir d’envol de
l’homme, ce à quoi s’accorde le titre, Icare, et ce, d’autant que des nuages en mouvement s’y projettent.
En outre, dépassant la citation savante, l’installation dans la répétition des nuages produit une sensation
d’apesanteur comme si vous-même ne touchiez plus le sol.
Même si son titre explicite moins la fondation philosophique pour simplement désigner littéralement la
machinerie-installation Shadow Machine garde la réflexion sur l’homme et sur l’image.
Le long des stalles de bois de la chapelle, un grand écran ; devant lequel, un système tourne à
vue, composé de bandes sur lesquelles sont accrochées de petites formes d’arbres, dénudées, noires.
Les poulies, les petites colonnes pour soutenir le mouvement s’affichent, de même que la lampe en
premier plan, qui, à chaque passage des arbres, en projette l’ombre sur un grand écran blanc.
La simplicité n’est pas sans calcul y compris pour la vitesse de rotation, calculée afin que plusieurs
silhouettes se croisent et bien plus, dépassant leurs deux dimensions, elles provoquent une forêt
fantomatique en se superposant. La machine outil crée les trois dimensions sans nécessiter d’effets dits
spéciaux.
Le mouvement du noir sur le blanc avec ses intermittences revient aux expériences des avant-gardes,
dans leur souci de l’abstraction rythmique, cependant, la figuration demeure dans cette installation-ci qui
sans réfuter ces fondamentaux du cinéma, revient à l’induction de pensée par le signifiant à l’œuvre.
Au-delà de l’iconogénie de la machine - étymologiquement création d’images -, les formes assument
l’incidence du sens ; l’ombre n’est pas le simple remplissage d’un contour, elle n’est pas vaine, elle réveille
nos présupposés.
La machine ne joue pas pour rien, elle provoque la réflexion - et la continuation du jeu sur les mots n’a
qu’à se poursuivre - sur la réalité de ce à quoi nous assistons. Ces ombres naissent et s’effilochent là, elles
ne sont que quand le corps modèle passe.
Ainsi la fille de Butadès, potier de Sicyone, ne peut–elle être convoquée, même si elle figure, dès
l’ancienne Grèce, parmi les légendes de l’origine de l’image comme image de l’homme et faite par lui. En
effet, lorsque la jeune amoureuse dessina le profil de celui qu’elle aimait avant son départ pour la guerre,
cette silhouette resta sur le mur en attestation de présence au moment du tracé.
Dès lors, qu’en est-il de la référence convoquée de la fondation de l’ombre dans le livre VII de
La République de Platon, où enchâssée dans un dialogue consacré à l’essence de la polis / la cité –
l’allégorie de la caverne est censée éclairer la réflexion, alors que Socrate y parle par énigme, à Glaucon
qui doit en découvrir le sens caché. Que Platon qualifie le récit d’allégorique et non de mythe découvre
son projet, celui d’arracher le discours rationnel, le logos au muthos tout en lui accordant une dimension
imaginaire.
En effet, Platon, ce que ne fait plus Aristote, explique sa pensée par des images, en une
stratégie pensée sur des rapports concept / image. L’allégorie sous le couvert de l’image exprime une
pensée, la rendant plus sensible. Et elle porte au moins deux sens, l’un littéral, immédiatement compré-
hensible, « transparent » sans ombre, et un sens caché qui réclame une exégèse, une aléthéia / le
dévoilement.
L’allégorie fait de l’ombre une image de la réalité non pas incertaine, mais trompeuse. Elle le fait en inven-
tant une scène d’enfermement de personnes assises et enchaînées devant une paroi rocheuse, de telle
manière qu’elles ne peuvent regarder que droit devant elles.
136 Installations / Expositions - Faut Voir