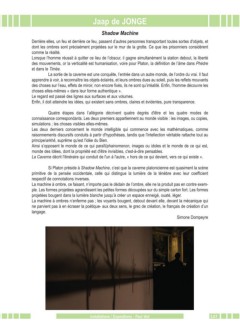Page 137 - catalogue_2012
P. 137
Jaap de JONGE
Shadow Machine
Derrière elles, un feu et derrière ce feu, passent d’autres personnes transportant toutes sortes d'objets, et
dont les ombres sont précisément projetées sur le mur de la grotte. Ce que les prisonniers considèrent
comme la réalité.
Lorsque l’homme réussit à quitter ce lieu de l’obscur, il gagne simultanément la station debout, la liberté
des mouvements, or la verticalité est humanisation, voire pour Platon, la définition de l’âme dans Phèdre
et dans le Timée.
La sortie de la caverne est une conquête, l’entrée dans un autre monde, de l’ordre du vrai. Il faut
apprendre à voir, à reconnaître les objets éclairés, et leurs ombres dues au soleil, puis les reflets mouvants
des choses sur l’eau, effets de miroir, non encore fixés, ils ne sont qu’irréalité. Enfin, l’homme découvre les
choses elles-mêmes « dans leur forme authentique ».
Le regard est passé des lignes aux surfaces et aux volumes.
Enfin, il doit atteindre les idées, qui existent sans ombres, claires et évidentes, pure transparence.
Quatre étapes dans l’allégorie décrivent quatre degrés d'être et les quatre modes de
connaissance correspondants. Les deux premiers appartiennent au monde visible : les images, ou copies,
simulations ; les choses visibles elles-mêmes.
Les deux derniers concernent le monde intelligible qui commence avec les mathématiques, comme
raisonnements discursifs conduits à partir d'hypothèses, tandis que l'intellection véritable rattache tout au
principe/arkhê, suprême qu'est l'idée du Bien.
Ainsi s’opposent le monde de ce qui paraît/phainomenon, images ou idoles et le monde de ce qui est,
monde des Idées, dont la propriété est d'être invisibles, c'est-à-dire pensables.
La Caverne décrit l'itinéraire qui conduit de l'un à l'autre, « hors de ce qui devient, vers ce qui existe ».
Si Platon préside à Shadow Machine, c’est que la caverne platonicienne est quasiment la scène
primitive de la pensée occidentale, celle qui distingue la lumière de la ténèbre avec leur coefficient
respectif de connotations inverses.
La machine à ombre, ce faisant, n’importe pas le dédain de l’ombre, elle ne la produit pas en contre exem-
ple. Les formes projetées agrandissent les petites formes découpées sur du simple carton fort. Les formes
projetées bougent dans la lumière blanche jusqu’à créer un espace enneigé, ouaté, léger.
La machine à ombres n’enferme pas ; les voyants bougent, debout devant elle, devant la mécanique qui
ne parvient pas à en écraser la poétique- aux deux sens, le grec de création, le français de création d’un
langage.
Simone Dompeyre
Installations / Expositions - Faut Voir 137