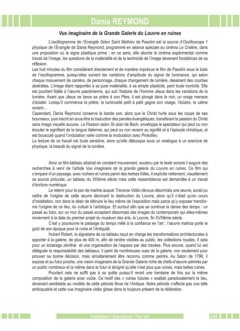Page 143 - catalogue_2012
P. 143
Dania REYMOND
Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines
L’oscillogramme de l’Evangile Selon Saint Mathieu de Pasolini est la source d’Oscilloscope 1
physique de l’Evangile de Dania Reymond, programmé en séance spéciale au cinéma Le Cratère, dans
une proposition où le signe plastique prime ; en ce sens, elle aborde le cinéma expérimental comme
travail de l’image, les questions de la matérialité et de la technicité de l’image devenant fondatrices de sa
réflexion.
Les huit minutes du film considèrent directement et de manière imprévue le film de Pasolini sous le biais
de l’oscillogramme, puisqu’elles suivent les variations d’amplitude du signal de luminance, qui selon
chaque mouvement de caméra, de personnage, chaque changement de lumière, dessinent des courbes
abstraites. L’image étant rapportée à sa pure matérialité, à sa simple plasticité, perd toute iconicité. Elle
est pourtant fidèle à l’œuvre pasolinienne, qui suit l’histoire de l’homme Jésus dans les variations de la
lumière. Avant que Jésus ne lance sa prière à son Père, il est plongé dans le noir, un orage menace
d’éclater. Lorsqu’il commence la prière, la luminosité petit à petit gagne son visage, l’éclaire, le calme
revient…
Cependant, Dania Reymond conserve la bande son, alors que le Christ hurle sous les coups de ses
bourreaux, puis inscrit en sous-titre la traduction des paroles évangéliques, transférant la passion du Christ
sans image visuelle aucune. La Passion selon St-Jean de Bach, enveloppe le spectateur qui peut ou non
écouter le signifiant de la langue italienne, qui peut ou non revenir au signifié et à l’épisode christique, et
est bousculé quand l’ondulation varie comme la modulation avec Prokofiev.
La lecture de ce travail est toute sensitive, alors qu’elle débusque sous un analogue à un exercice de
physique, la beauté du signal de la lumière.
Ainsi ce film-tableau abstrait en constant mouvement, soutenu par le texte sonore il augure des
recherches à venir de l’artiste Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines. Ce film qui
s’empare d’un paysage, avec rochers et ruines parmi des herbes folles, il explicite nettement, visuellement
sa source picturale, un tableau du XIXème siècle mais cette ressemblance est demandée à un travail
d’écriture numérique.
Le retenir pour le pan de marbre auquel Traverse Vidéo dévoue désormais une œuvre, aurait pu
naître de l’origine de cette œuvre décrivant la destruction du Louvre, alors qu’il n’était qu’en cours
d'installation, non dans le désir de détruire le lieu même de l’exposition mais parce qu’y exposer transfor-
me l’origine de ce lieu, du cultuel à l’artistique. Et surtout afin que se continue la danse des temps : un
passé au futur, sur un mur du passé acceptant désormais des images du contemporain qui elles-mêmes
reviennent à la date du premier projet du muséum des arts, le Louvre, fin XVIIIème siècle.
C’est y poursuivre le passage du temps mêlé à la confiance en l’art ; l’œuvre matrice porte le
goût de son époque pour la ruine et l’Antiquité.
Hubert Robert, le signataire de ce tableau reçut en charge les transformations architecturales à
apporter à la galerie, de plus de 400 m, afin de rendre visibles au public, les collections royales. Il opta
pour un éclairage zénithal et une organisation de l’espace par des travées. Plus encore, quand lui est
déléguée la responsabilité des tableaux, il peint de nombreuses vues de la galerie, non seulement pour
prouver sa bonne décision, mais simultanément être reconnu comme peintre. Au Salon de 1796, il
expose et au futur proche, une vision imaginaire de la Grande Galerie riche de chefs-d’œuvre admirés par
un public nombreux et la même dans le futur si éloigné qu’elle n’est plus que ruines, mais belles ruines.
Pourtant cela ne suffit pas à sa quête puisqu’il revint une trentaine de fois sur la même
composition de la galerie avec voûte. Ce motif des « ruines futures » exaltait paradoxalement le lieu,
devenant semblable au modèle de cette période férue de l’Antique. Notre période n’affecte pas une telle
antiloquatrie et cette vue imaginaire vidéo glisse dans le toujours présent de la réitération.
Installations / Expositions - Faut Voir 143