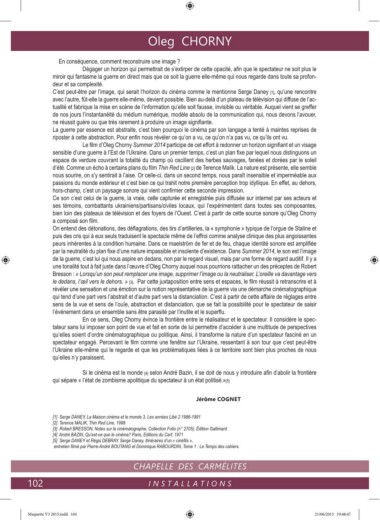Page 103 - catalogue_2015
P. 103
Oleg CHORNY
En conséquence, comment reconstruire une image ?
Dégager un horizon qui permettrait de s’extirper de cette opacité, afin que le spectateur ne soit plus le
miroir qui fantasme la guerre en direct mais que ce soit la guerre elle-même qui nous regarde dans toute sa profon-
deur et sa complexité.
C’est peut-être par l’image, qui serait l’horizon du cinéma comme le mentionne Serge Daney [1], qu’une rencontre
avec l’autre, fût-elle la guerre elle-même, devient possible. Bien au-delà d’un plateau de télévision qui diffuse de l’ac-
tualité et fabrique la mise en scène de l’information qu’elle soit fausse, invisible ou véritable. Auquel vient se greffer
de nos jours l’instantanéité du médium numérique, modèle absolu de la communication qui, nous devons l’avouer,
ne réussit guère ou que très rarement à produire un image signifiante.
La guerre par essence est abstraite, c’est bien pourquoi le cinéma par son langage a tenté à maintes reprises de
riposter à cette abstraction. Pour enfin nous révéler ce qu’on a vu, ce qu’on n’a pas vu, ce qu’ils ont vu.
Le film d’Oleg Chorny Summer 2014 participe de cet effort à redonner un horizon signifiant et un visage
sensible d’une guerre à l’Est de l’Ukraine. Dans un premier temps, c’est un plan fixe par lequel nous distinguons un
espace de verdure couvrant la totalité du champ où oscillent des herbes sauvages, fanées et dorées par le soleil
d’été. Comme un écho à certains plans du film Thin Red Line [2] de Terence Malik. La nature est présente, elle semble
nous sourire, on s’y sentirait à l’aise. Or celle-ci, dans un second temps, nous paraît insensible et imperméable aux
passions du monde extérieur et c’est bien ce qui trahit notre première perception trop idyllique. En effet, au dehors,
hors-champ, c’est un paysage sonore qui vient confirmer cette seconde impression.
Ce son c’est celui de la guerre, la vraie, celle capturée et enregistrée puis diffusée sur internet par ses acteurs et
ses témoins, combattants ukrainiens/partisans/civiles locaux, qui l’expérimentent dans toutes ses composantes,
bien loin des plateaux de télévision et des foyers de l’Ouest. C’est à partir de cette source sonore qu’Oleg Chorny
a composé son film.
On entend des détonations, des déflagrations, des tirs d’artilleries, la « symphonie » typique de l’orgue de Staline et
puis des cris qui à eux seuls traduisent le spectacle même de l’effroi comme analyse clinique des plus angoissantes
peurs inhérentes à la condition humaine. Dans ce maelström de fer et de feu, chaque identité sonore est amplifiée
par la neutralité du plan fixe d’une nature impassible et insolente d’existence. Dans Summer 2014, le son est l’image
de la guerre, c’est lui qui nous aspire en dedans, non par le regard visuel, mais par une forme de regard auditif. Il y a
une tonalité tout à fait juste dans l’œuvre d’Oleg Chorny auquel nous pourrions rattacher un des préceptes de Robert
Bresson : « Lorsqu’un son peut remplacer une image, supprimer l’image ou la neutraliser. L’oreille va davantage vers
le dedans, l’œil vers le dehors. » [3]. Par cette juxtaposition entre sens et espaces, le film réussit à retranscrire et à
révéler une sensation et une émotion sur la notion représentative de la guerre via une démarche cinématographique
qui tend d’une part vers l’abstrait et d’autre part vers la distanciation. C’est à partir de cette affaire de réglages entre
sens de la vue et sens de l’ouïe, abstraction et distanciation, que se fait la possibilité pour le spectateur de saisir
l’événement dans un ensemble sans être parasité par l’inutile et le superflu.
En ce sens, Oleg Chorny évince la frontière entre le réalisateur et le spectateur. Il considère le spec-
tateur sans lui imposer son point de vue et fait en sorte de lui permettre d’accéder à une multitude de perspectives
qu’elles soient d’ordre cinématographique ou politique. Ainsi, il transforme la nature d’un spectateur fasciné en un
spectateur engagé. Percevant le film comme une fenêtre sur l’Ukraine, ressentant à son tour que c’est peut-être
l’Ukraine elle-même qui le regarde et que les problématiques liées à ce territoire sont bien plus proches de nous
qu’elles n’y paraissent.
Si le cinéma est le monde [4] selon André Bazin, il se doit de nous y introduire afin d’abolir la frontière
qui sépare « l’état de zombisme apolitique du spectateur à un état politisé.»[5]
Jérôme COGNET
[1] Serge DANEY, La Maison cinéma et le monde 3. Les années Libé 2 1986-1991
[2] Terence MALIK, Thin Red Line, 1998
[3] Robert BRESSON, Notes sur le cinématographe, Collection Folio (n° 2705), Édition Gallimard
[4] André BAZIN, Qu’est-ce que le cinéma? Paris, Editions du Cerf, 1971
[5] Serge DANEY et Régis DEBRAY, Serge Daney, Itinéraires d’un « cinéfils »,
entretien filmé par Pierre-André BOUTANG et Dominique RABOURDIN, Tome 1 : Le Temps des cahiers.
CHAPELLE DES CARMÉLITES
102 I N S T A L L A T I O N S
Maquette V3 2015.indd 104 21/06/2015 19:48:47