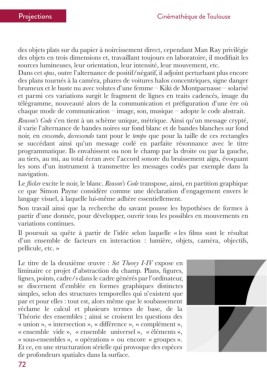Page 72 - Catalogue-livre_Rencontres Traverse 2019_L'Expérimental-recherche-art
P. 72
Projections Cinémathèque de Toulouse
des objets plats sur du papier à noircissement direct, cependant Man Ray privilégie
des objets en trois dimensions et, travaillant toujours en laboratoire, il modifiait les
sources lumineuses, leur orientation, leur intensité, leur mouvement, etc.
Dans cet opus, outre l’alternance de positif/négatif, il adjoint perturbant plus encore
des plans tournés à la caméra, phares de voitures halos concentriques, signe danger
brumeux et le buste nu avec volutes d’une femme – Kiki de Montparnasse – solarisé
et parmi ces variations surgit le fragment de lignes en traits cadencés, image du
télégramme, nouveauté alors de la communication et préfiguration d’une ère où
chaque mode de communication – image, son, musique – adopte le code abstrait.
Reason’s Code s’en tient à un schème unique, métrique. Ainsi qu’un message crypté,
il varie l’alternance de bandes noires sur fond blanc et de bandes blanches sur fond
noir, en crescendo, decrescendo tant pour le tempo que pour la taille de ces rectangles
se succédant ainsi qu’un message codé en parfaite résonnance avec le titre
programmatique. Ils envahissent ou non le champ par la droite ou par la gauche,
au tiers, au mi, au total écran avec l’accord sonore du bruissement aigu, évoquant
les sons d’un instrument à transmettre les messages codés par exemple dans la
navigation.
Le flicker excite le noir, le blanc. Reason’s Code transpose, ainsi, en partition graphique
ce que Simon Payne considère comme une déclaration d’engagement envers le
langage visuel, à laquelle lui-même adhère essentiellement.
Son travail ainsi que la recherche du savant pousse les hypothèses de formes à
partir d’une donnée, pour développer, ouvrir tous les possibles en mouvements en
variations continues.
Il poursuit sa quête à partir de l’idée selon laquelle « les films sont le résultat
d’un ensemble de facteurs en interaction : lumière, objets, caméra, objectifs,
pellicule, etc. »
Le titre de la deuxième œuvre : Set Theory I-IV expose en
liminaire ce projet d’abstraction du champ. Plans, figures,
lignes, points, cadre/s dans le cadre générés par l’ordinateur,
se discernent d’emblée en formes graphiques distinctes
simples, selon des structures temporelles qui n’existent que
par et pour elles : tout est, alors même que le soubassement
réclame le calcul et plusieurs termes de base, de la
Théorie des ensembles ; ainsi se croisent les questions des
« union », « intersection », « différence », « complément »,
« ensemble vide », « ensemble universel », « éléments »,
« sous-ensembles », « opérations » ou encore « groupes ».
Et ce, en une structuration sérielle qui provoque des espèces
de profondeurs spatiales dans la surface.
72