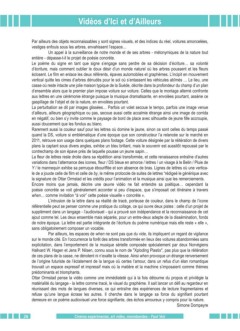Page 26 - catalogue_2012
P. 26
Vidéos d’Ici et d’Ailleurs
Par ailleurs des objets reconnaissables y sont signes visuels, et des indices du réel, voitures amoncelées,
vestiges enfouis sous les arbres, envahissent l’espace…
Un appel à la surveillance de notre monde et de ses arbres - métonymiques de la nature tout
entière - dépasse-t-il le projet de poésie concrète.
Le poème du signe en tant que signe s’engage sans perdre de sa décision d’écriture… sa volonté
d’écriture, mais comment oublier le doux désir d’un monde naturel où les arbres poussent et les fleurs
éclosent. Le film en enlace les deux référents, épaves automobiles et graphèmes. L’incipit en mouvement
vertical quitte les cimes d’arbres dénudés pour le sol où s’entassent les véhicules abîmés … Le lieu, une
casse où reste intacte une jolie maison typique de la Suède, décrite dans la profondeur du champ d’un plan
d’ensemble alors que le premier plan impose voiture sur voiture. Celles que le montage alterné confronte
aux lettres en une cérémonie étrange puisque la musique dramatisante, en envolées pourtant, assène ce
gaspillage de l’objet et de la nature, en envolées pourtant.
La perturbation se dit par images glissées… Parfois un volet secoue le tempo, parfois une image venue
d’ailleurs, ailleurs géographique ou pas, secoue aussi cette accalmie étrange ainsi une image de corrida
en négatif, ou bien s’y invite comme le paysage de bord de place avec silhouette de jeune fille accroupie,
aussi doucement que les fondus au blanc.
Rarement aussi la couleur sauf pour les lettres où domine le jaune, sinon ce sont celles du temps passé
quand la DS, voiture si emblématique d’une époque que son constructeur l’a relancée sur le marché en
2011, retrouve son usage dans quelques plans footage. Cette voiture désignée par la réitération de divers
plans la captant sous divers angles, exhibe un bleu brillant, mais le souvenir est aussitôt repoussé par le
contrechamp de son épave près de laquelle pousse un jeune sapin…
La fleur de lettres reste droite dans sa répétition ainsi transformée, et cette renaissance entraîne d’autres
variations dans l’alternance des icones, fleur / DS bleue en amorce / lettres / un visage à le Belin / Pluie de
Y / le mannequin exhibe sa perruque ébouriffée et son absence de bras. Lignes de lettres où une vertica-
le de a jouxte celle de film et celle de by, le même protocole de suites de lettres “rédigeé le générique avec
la signature de Ottar Ormstad et les crédits pour l’animation et la musique ainsi que les remerciements.
Encore moins que jamais, décrire une œuvre vidéo ne fait entendre sa poétique… cependant la
poésie concrète se voit généralement accorder si peu d’espace, que s’imposait cet itinéraire à travers
when… comme invitation “à voir” cette poésie visuelle « concrète ».
L’intrusion de la lettre dans sa réalité de tracé, porteuse de couleur, dans le champ de l’icone
référentielle peut se penser comme une pratique du collage, ce qui ouvre deux pistes : celle d’un projet de
supplément dans un langage - l’audiovisuel - qui a prouvé son indépendance et la reconnaissance de cet
ajout comme tel. Les deux ensemble mais séparés, pour un entre-deux adepte de la dissémination, fonds
de notre époque. La lettre est partie intégrante de l’écriture du poème numérique mais elle reste « elle »,
sans obligatoirement composer un vocable.
Par ailleurs, les espaces de when ne sont pas que du vide, ils impliquent un regard de vigilance
sur le monde cité. En l’occurrence la forêt des arbres transformée en lieux des voitures abandonnées sans
explicitation, dans l’emportement de la musique sérielle composée spécialement par deux Norvégiens
Hallvard W. Hagen et Jens P. Nilsen, connu sous le nom de "Xploding Plastix", pas plus que la réitération
de ces plans de la casse, ne dénotent ni n’exalte la vitesse. Ainsi when provoque un étrange renversement
de l’origine futuriste de l’éclatement de la langue où certes l’amour, dans un refus d’un élan romantique
trouvait un espace expressif et impressif mais où la matière et la machine s’imposaient comme thèmes
prédominants et triomphants.
Ottar Ormstad pense la vidéo comme une immédiateté qui à la fois détourne du propos et privilégie la
matérialité du langage - la lettre comme tracé, le visuel du graphème. Il sait lancer un défi au regardeur en
réunissant des mots de langues diverses, ce qui entraîne des expériences de lecture fragmentaires et
refuse qu’une langue écrase les autres. Il cherche dans le langage sa force du signifiant pourtant
demeure en ce poème audiovisuel une force signifiante, des échos amoureux y compris pour la nature.
Simone Dompeyre
26 Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Faut Voir