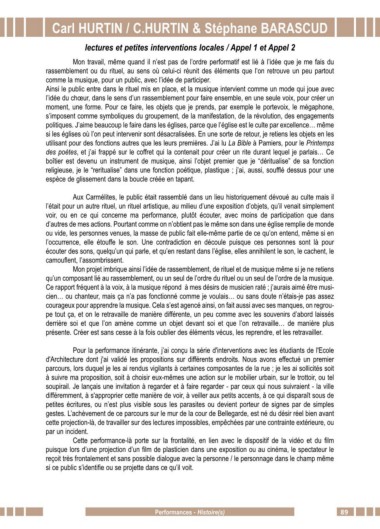Page 88 - catalogue_2013
P. 88
Carl HURTIN / C.HURTIN & Stéphane BARASCUD
lectures et petites interventions locales / Appel 1 et Appel 2
Mon travail, même quand il n’est pas de l’ordre performatif est lié à l’idée que je me fais du
rassemblement ou du rituel, au sens où celui-ci réunit des éléments que l’on retrouve un peu partout
comme la musique, pour un public, avec l’idée de participer.
Ainsi le public entre dans le rituel mis en place, et la musique intervient comme un mode qui joue avec
l’idée du chœur, dans le sens d’un rassemblement pour faire ensemble, en une seule voix, pour créer un
moment, une forme. Pour ce faire, les objets que je prends, par exemple le portevoix, le mégaphone,
s’imposent comme symboliques du groupement, de la manifestation, de la révolution, des engagements
politiques. J’aime beaucoup le faire dans les églises, parce que l’église est le culte par excellence… même
si les églises où l’on peut intervenir sont désacralisées. En une sorte de retour, je retiens les objets en les
utilisant pour des fonctions autres que les leurs premières. J’ai lu La Bible à Pamiers, pour le Printemps
des poètes, et j’ai frappé sur le coffret qui la contenait pour créer un rite durant lequel je parlais… Ce
boîtier est devenu un instrument de musique, ainsi l’objet premier que je “déritualise” de sa fonction
religieuse, je le “reritualise” dans une fonction poétique, plastique ; j’ai, aussi, soufflé dessus pour une
espèce de glissement dans la boucle créée en tapant.
Aux Carmélites, le public était rassemblé dans un lieu historiquement dévoué au culte mais il
l’était pour un autre rituel, un rituel artistique, au milieu d’une exposition d’objets, qu’il venait simplement
voir, ou en ce qui concerne ma performance, plutôt écouter, avec moins de participation que dans
d’autres de mes actions. Pourtant comme on n’obtient pas le même son dans une église remplie de monde
ou vide, les personnes venues, la masse de public fait elle-même partie de ce qu’on entend, même si en
l’occurrence, elle étouffe le son. Une contradiction en découle puisque ces personnes sont là pour
écouter des sons, quelqu’un qui parle, et qu’en restant dans l’église, elles annihilent le son, le cachent, le
camouflent, l’assombrissent.
Mon projet imbrique ainsi l’idée de rassemblement, de rituel et de musique même si je ne retiens
qu’un composant lié au rassemblement, ou un seul de l’ordre du rituel ou un seul de l’ordre de la musique.
Ce rapport fréquent à la voix, à la musique répond à mes désirs de musicien raté ; j’aurais aimé être musi-
cien… ou chanteur, mais ça n’a pas fonctionné comme je voulais… ou sans doute n’étais-je pas assez
courageux pour apprendre la musique. Cela s’est agencé ainsi, on fait aussi avec ses manques, on regrou-
pe tout ça, et on le retravaille de manière différente, un peu comme avec les souvenirs d’abord laissés
derrière soi et que l’on amène comme un objet devant soi et que l’on retravaille… de manière plus
présente. Créer est sans cesse à la fois oublier des éléments vécus, les reprendre, et les retravailler.
Pour la performance itinérante, j’ai conçu la série d'interventions avec les étudiants de l'Ecole
d'Architecture dont j'ai validé les propositions sur différents endroits. Nous avons effectué un premier
parcours, lors duquel je les ai rendus vigilants à certaines composantes de la rue ; je les ai sollicités soit
à suivre ma proposition, soit à choisir eux-mêmes une action sur le mobilier urbain, sur le trottoir, ou tel
soupirail. Je lançais une invitation à regarder et à faire regarder - par ceux qui nous suivraient - la ville
différemment, à s'approprier cette manière de voir, à veiller aux petits accents, à ce qui disparaît sous de
petites écritures, ou n’est plus visible sous les parasites ou devient porteur de signes par de simples
gestes. L’achèvement de ce parcours sur le mur de la cour de Bellegarde, est né du désir réel bien avant
cette projection-là, de travailler sur des lectures impossibles, empêchées par une contrainte extérieure, ou
par un incident.
Cette performance-là porte sur la frontalité, en lien avec le dispositif de la vidéo et du film
puisque lors d’une projection d’un film de plasticien dans une exposition ou au cinéma, le spectateur le
reçoit très frontalement et sans possible dialogue avec la personne / le personnage dans le champ même
si ce public s’identifie ou se projette dans ce qu’il voit.
Performances - Histoire(s) 89