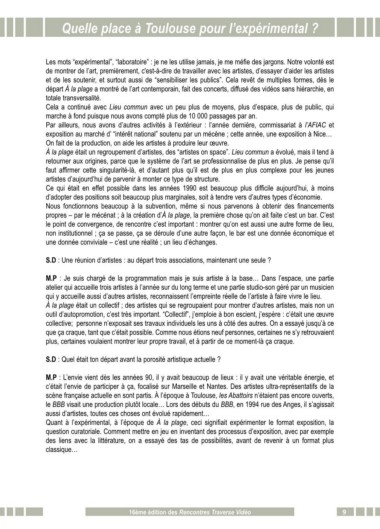Page 9 - catalogue_2013
P. 9
Quelle place à Toulouse pour l’expérimental ?
Les mots “expérimental”, “laboratoire” : je ne les utilise jamais, je me méfie des jargons. Notre volonté est
de montrer de l’art, premièrement, c'est-à-dire de travailler avec les artistes, d’essayer d’aider les artistes
et de les soutenir, et surtout aussi de “sensibiliser les publics”. Cela revêt de multiples formes, dès le
départ À la plage a montré de l’art contemporain, fait des concerts, diffusé des vidéos sans hiérarchie, en
totale transversalité.
Cela a continué avec Lieu commun avec un peu plus de moyens, plus d’espace, plus de public, qui
marche à fond puisque nous avons compté plus de 10 000 passages par an.
Par ailleurs, nous avons d’autres activités à l’extérieur : l’année dernière, commissariat à l’AFIAC et
exposition au marché d’ “intérêt national” soutenu par un mécène ; cette année, une exposition à Nice…
On fait de la production, on aide les artistes à produire leur œuvre.
À la plage était un regroupement d’artistes, des “artistes on space”. Lieu commun a évolué, mais il tend à
retourner aux origines, parce que le système de l’art se professionnalise de plus en plus. Je pense qu’il
faut affirmer cette singularité-là, et d’autant plus qu’il est de plus en plus complexe pour les jeunes
artistes d’aujourd’hui de parvenir à monter ce type de structure.
Ce qui était en effet possible dans les années 1990 est beaucoup plus difficile aujourd’hui, à moins
d’adopter des positions soit beaucoup plus marginales, soit à tendre vers d’autres types d’économie.
Nous fonctionnons beaucoup à la subvention, même si nous parvenons à obtenir des financements
propres – par le mécénat ; à la création d’À la plage, la première chose qu’on ait faite c’est un bar. C’est
le point de convergence, de rencontre c’est important : montrer qu’on est aussi une autre forme de lieu,
non institutionnel ; ça se passe, ça se déroule d’une autre façon, le bar est une donnée économique et
une donnée conviviale – c’est une réalité ; un lieu d’échanges.
S.D : Une réunion d’artistes : au départ trois associations, maintenant une seule ?
M.P : Je suis chargé de la programmation mais je suis artiste à la base… Dans l’espace, une partie
atelier qui accueille trois artistes à l’année sur du long terme et une partie studio-son géré par un musicien
qui y accueille aussi d’autres artistes, reconnaissent l’empreinte réelle de l’artiste à faire vivre le lieu.
À la plage était un collectif ; des artistes qui se regroupaient pour montrer d’autres artistes, mais non un
outil d’autopromotion, c’est très important. “Collectif”, j’emploie à bon escient, j’espère : c’était une œuvre
collective; personne n’exposait ses travaux individuels les uns à côté des autres. On a essayé jusqu’à ce
que ça craque, tant que c’était possible. Comme nous étions neuf personnes, certaines ne s’y retrouvaient
plus, certaines voulaient montrer leur propre travail, et à partir de ce moment-là ça craque.
S.D : Quel était ton départ avant la porosité artistique actuelle ?
M.P : L’envie vient dès les années 90, il y avait beaucoup de lieux : il y avait une véritable énergie, et
c’était l’envie de participer à ça, focalisé sur Marseille et Nantes. Des artistes ultra-représentatifs de la
scène française actuelle en sont partis. À l’époque à Toulouse, les Abattoirs n’étaient pas encore ouverts,
le BBB visait une production plutôt locale… Lors des débuts du BBB, en 1994 rue des Anges, il s’agissait
aussi d’artistes, toutes ces choses ont évolué rapidement…
Quant à l’expérimental, à l’époque de À la plage, ceci signifiait expérimenter le format exposition, la
question curatoriale. Comment mettre en jeu en inventant des processus d’exposition, avec par exemple
des liens avec la littérature, on a essayé des tas de possibilités, avant de revenir à un format plus
classique…
16ème édition des Rencontres Traverse Vidéo 9