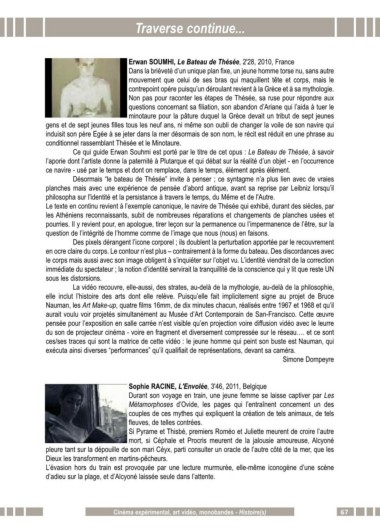Page 67 - catalogue_2013
P. 67
Traverse continue...
Erwan SOUMHI, Le Bateau de Thésée, 2'28, 2010, France
Dans la brièveté d’un unique plan fixe, un jeune homme torse nu, sans autre
mouvement que celui de ses bras qui maquillent tête et corps, mais le
contrepoint opère puisqu’un déroulant revient à la Grèce et à sa mythologie.
Non pas pour raconter les étapes de Thésée, sa ruse pour répondre aux
questions concernant sa filiation, son abandon d’Ariane qui l’aida à tuer le
minotaure pour la pâture duquel la Grèce devait un tribut de sept jeunes
gens et de sept jeunes filles tous les neuf ans, ni même son oubli de changer la voile de son navire qui
induisit son père Egée à se jeter dans la mer désormais de son nom, le récit est réduit en une phrase au
conditionnel rassemblant Thésée et le Minotaure.
Ce qui guide Erwan Souhmi est porté par le titre de cet opus : Le Bateau de Thésée, à savoir
l’aporie dont l’artiste donne la paternité à Plutarque et qui débat sur la réalité d’un objet - en l’occurrence
ce navire - usé par le temps et dont on remplace, dans le temps, élément après élément.
Désormais “le bateau de Thésée” invite à penser ; ce syntagme n’a plus lien avec de vraies
planches mais avec une expérience de pensée d’abord antique, avant sa reprise par Leibniz lorsqu’il
philosopha sur l'identité et la persistance à travers le temps, du Même et de l'Autre.
Le texte en continu revient à l’exemple canonique, le navire de Thésée qui exhibé, durant des siècles, par
les Athéniens reconnaissants, subit de nombreuses réparations et changements de planches usées et
pourries. Il y revient pour, en apologue, tirer leçon sur la permanence ou l’impermanence de l’être, sur la
question de l’intégrité de l’homme comme de l’image que nous (nous) en faisons.
Des pixels dérangent l’icone corporel ; ils doublent la perturbation apportée par le recouvrement
en ocre claire du corps. Le contour n’est plus – contrairement à la forme du bateau. Des discordances avec
le corps mais aussi avec son image obligent à s’inquiéter sur l’objet vu. L’identité viendrait de la correction
immédiate du spectateur ; la notion d’identité servirait la tranquillité de la conscience qui y lit que reste UN
sous les distorsions.
La vidéo recouvre, elle-aussi, des strates, au-delà de la mythologie, au-delà de la philosophie,
elle inclut l’histoire des arts dont elle relève. Puisqu’elle fait implicitement signe au projet de Bruce
Nauman, les Art Make-up, quatre films 16mm, de dix minutes chacun, réalisés entre 1967 et 1968 et qu’il
aurait voulu voir projetés simultanément au Musée d’Art Contemporain de San-Francisco. Cette œuvre
pensée pour l’exposition en salle carrée n’est visible qu’en projection voire diffusion vidéo avec le leurre
du son de projecteur cinéma - voire en fragment et diversement compressée sur le réseau…. et ce sont
ces/ses traces qui sont la matrice de cette vidéo : le jeune homme qui peint son buste est Nauman, qui
exécuta ainsi diverses “performances” qu’il qualifiait de représentations, devant sa caméra.
Simone Dompeyre
Sophie RACINE, L'Envolée, 3'46, 2011, Belgique
Durant son voyage en train, une jeune femme se laisse captiver par Les
Métamorphoses d’Ovide, les pages qui l’entraînent concernent un des
couples de ces mythes qui expliquent la création de tels animaux, de tels
fleuves, de telles contrées.
Si Pyrame et Thisbé, premiers Roméo et Juliette meurent de croire l’autre
mort, si Céphale et Procris meurent de la jalousie amoureuse, Alcyoné
pleure tant sur la dépouille de son mari Céyx, parti consulter un oracle de l’autre côté de la mer, que les
Dieux les transforment en martins-pêcheurs.
L’évasion hors du train est provoquée par une lecture murmurée, elle-même iconogène d’une scène
d’adieu sur la plage, et d’Alcyoné laissée seule dans l’attente.
Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s) 67