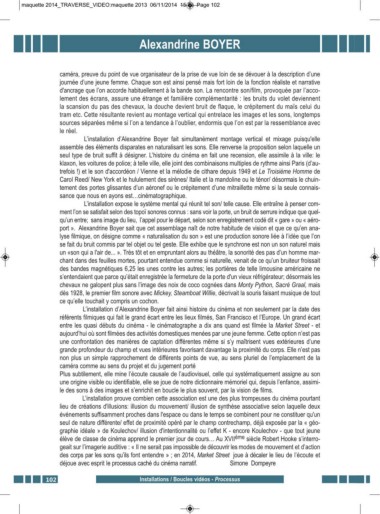Page 103 - catalogue_2014
P. 103
maquette 2014_TRAVERSE_VIDEO:maquette 2013 06/11/2014 15:53 Page 102
Alexandrine BOYER
caméra, preuve du point de vue organisateur de la prise de vue loin de se dévouer à la description d’une
journée d’une jeune femme. Chaque son est ainsi pensé mais fort loin de la fonction réaliste et narrative
d'ancrage que l’on accorde habituellement à la bande son. La rencontre son/film, provoquée par l’acco-
lement des écrans, assure une étrange et familière complémentarité : les bruits du volet deviennent
la scansion du pas des chevaux, la douche devient bruit de flaque, le crépitement du maïs celui du
tram etc. Cette résultante revient au montage vertical qui entrelace les images et les sons, longtemps
sources séparées même si l’on a tendance à l’oublier, endormis que l’on est par la ressemblance avec
le réel.
L’installation d’Alexandrine Boyer fait simultanément montage vertical et mixage puisqu'elle
assemble des éléments disparates en naturalisant les sons. Elle renverse la proposition selon laquelle un
seul type de bruit suffit à désigner. L’histoire du cinéma en fait une recension, elle assimile à la ville: le
klaxon, les voitures de police; à telle ville, elle joint des combinaisons multiples de rythme ainsi Paris (d’au-
trefois !) et le son d'accordéon / Vienne et la mélodie de cithare depuis 1949 et Le Troisième Homme de
Carol Reed/ New York et le hululement des sirènes/ Italie et la mandoline ou le ténor/ désormais le chuin-
tement des portes glissantes d’un aéronef ou le crépitement d’une mitraillette même si la seule connais-
sance que nous en ayons est…cinématographique.
L’installation expose le système mental qui réunit tel son/ telle cause. Elle entraîne à penser com-
ment l’on se satisfait selon des topoï sonores connus : sans voir la porte, un bruit de serrure indique que quel-
qu’un entre; sans image du lieu, l’appel pour le départ, selon son enregistrement codé dit « gare » ou « aéro-
port ». Alexandrine Boyer sait que cet assemblage naît de notre habitude de vision et que ce qu’en ana-
lyse filmique, on désigne comme « naturalisation du son » est une production sonore liée à l’idée que l’on
se fait du bruit commis par tel objet ou tel geste. Elle exhibe que le synchrone est non un son naturel mais
un «son qui a l'air de... ». Très tôt et en empruntant alors au théâtre, la sonorité des pas d’un homme mar-
chant dans des feuilles mortes, pourtant entendue comme si naturelle, venait de ce qu’un bruiteur froissait
des bandes magnétiques 6,25 les unes contre les autres; les portières de telle limousine américaine ne
s’entendaient que parce qu’était enregistrée la fermeture de la porte d'un vieux réfrigérateur; désormais les
chevaux ne galopent plus sans l’image des noix de coco cognées dans Monty Python, Sacré Graal, mais
dès 1928, le premier film sonore avec Mickey, Steamboat Willie, décrivait la souris faisant musique de tout
ce qu’elle touchait y compris un cochon.
L’installation d’Alexandrine Boyer fait ainsi histoire du cinéma et non seulement par la date des
référents filmiques qui fait le grand écart entre les lieux filmés, San Francisco et l’Europe. Un grand écart
entre les quasi débuts du cinéma - le cinématographe a dix ans quand est filmée la Market Street - et
aujourd’hui où sont filmées des activités domestiques menées par une jeune femme. Cette option n’est pas
une confrontation des manières de captation différentes même si s’y maîtrisent vues extérieures d’une
grande profondeur du champ et vues intérieures favorisant davantage la proximité du corps. Elle n’est pas
non plus un simple rapprochement de différents points de vue, au sens pluriel de l’emplacement de la
caméra comme au sens du projet et du jugement porté
Plus subtilement, elle mine l’écoute causale de l’audiovisuel, celle qui systématiquement assigne au son
une origine visible ou identifiable, elle se joue de notre dictionnaire mémoriel qui, depuis l’enfance, assimi-
le des sons à des images et s’enrichit en boucle le plus souvent, par la vision de films.
L’installation prouve combien cette association est une des plus trompeuses du cinéma pourtant
lieu de créations d'illusions: illusion du mouvement/ illusion de synthèse associative selon laquelle deux
événements suffisamment proches dans l'espace ou dans le temps se combinent pour ne constituer qu'un
seul de nature différente/ effet de proximité opéré par le champ contrechamp, déjà exposée par la « géo-
graphie idéale » de Koulechov/ illusion d'intentionnalité ou l’effet K - encore Koulechov - que tout jeune
élève de classe de cinéma apprend le premier jour de cours… Au XVIIème siècle Robert Hooke s’interro-
geait sur l’imagerie auditive : « Il ne serait pas impossible de découvrir les modes de mouvement et d’action
des corps par les sons qu’ils font entendre » ; en 2014, Market Street joue à décaler le lieu de l’écoute et
déjoue avec esprit le processus caché du cinéma narratif. Simone Dompeyre
102 Installations / Boucles vidéos - Processus