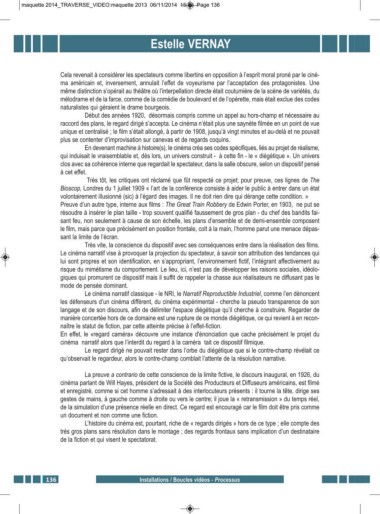Page 137 - catalogue_2014
P. 137
maquette 2014_TRAVERSE_VIDEO:maquette 2013 06/11/2014 15:53 Page 136
Estelle VERNAY
Cela revenait à considérer les spectateurs comme libertins en opposition à l’esprit moral proné par le ciné-
ma américain et, inversement, annulait l’effet de voyeurisme par l’acceptation des protagonistes. Une
même distinction s’opérait au théâtre où l’interpellation directe était coutumière de la scène de variétés, du
mélodrame et de la farce, comme de la comédie de boulevard et de l’opérette, mais était exclue des codes
naturalistes qui géraient le drame bourgeois.
Début des années 1920, désormais compris comme un appel au hors-champ et nécessaire au
raccord des plans, le regard dirigé s’accepta. Le cinéma n’était plus une saynète filmée en un point de vue
unique et centralisé ; le film s’était allongé, à partir de 1908, jusqu’à vingt minutes et au-delà et ne pouvait
plus se contenter d’improvisation sur canevas et de regards coquins.
En devenant machine à histoire(s), le cinéma créa ses codes spécifiques, liés au projet de réalisme,
qui induisait le vraisemblable et, dès lors, un univers construit - à cette fin - le « diégétique ». Un univers
clos avec sa cohérence interne que regardait le spectateur, dans la salle obscure, selon un dispositif pensé
à cet effet.
Très tôt, les critiques ont réclamé que fût respecté ce projet; pour preuve, ces lignes de The
Bioscop, Londres du 1 juillet 1909 « l’art de la conférence consiste à aider le public à entrer dans un état
volontairement illusionné (sic) à l’égard des images. Il ne doit rien dire qui dérange cette condition. »
Preuve d’un autre type, interne aux films : The Great Train Robbery de Edwin Porter, en 1903, ne put se
résoudre à insérer le plan taille - trop souvent qualifié faussement de gros plan - du chef des bandits fai-
sant feu, non seulement à cause de son échelle, les plans d’ensemble et de demi-ensemble composent
le film, mais parce que précisément en position frontale, colt à la main, l’homme parut une menace dépas-
sant la limite de l’écran.
Très vite, la conscience du dispositif avec ses conséquences entre dans la réalisation des films.
Le cinéma narratif vise à provoquer la projection du spectateur, à savoir son attribution des tendances qui
lui sont propres et son identification, en s’appropriant, l’environnement fictif, l’intégrant affectivement au
risque du mimétisme du comportement. Le lieu, ici, n’est pas de développer les raisons sociales, idéolo-
giques qui promurent ce dispositif mais il suffit de rappeler la chasse aux réalisateurs ne diffusant pas le
mode de pensée dominant.
Le cinéma narratif classique - le NRI, le Narratif Reproductible Industriel, comme l’en dénoncent
les défenseurs d’un cinéma différent, du cinéma expérimental - cherche la pseudo transparence de son
langage et de son discours, afin de délimiter l'espace diégétique qu’il cherche à construire. Regarder de
manière concertée hors de ce domaine est une rupture de ce monde diégétique, ce qui revient à en recon-
naître le statut de fiction, par cette atteinte précise à l’effet-fiction.
En effet, le «regard caméra» découvre une instance d'énonciation que cache précisément le projet du
cinéma narratif alors que l’interdit du regard à la caméra tait ce dispositif filmique.
Le regard dirigé ne pouvait rester dans l’orbe du diégétique que si le contre-champ révélait ce
qu’observait le regardeur, alors le contre-champ comblait l’attente de la résolution narrative.
La preuve a contrario de cette conscience de la limite fictive, le discours inaugural, en 1926, du
cinéma parlant de Will Hayes, président de la Société des Producteurs et Diffuseurs américains, est filmé
et enregistré, comme si cet homme s’adressait à des interlocuteurs présents : il tourne la tête, dirige ses
gestes de mains, à gauche comme à droite ou vers le centre; il joue la « retransmission » du temps réel,
de la simulation d’une présence réelle en direct. Ce regard est encouragé car le film doit être pris comme
un document et non comme une fiction.
L’histoire du cinéma est, pourtant, riche de « regards dirigés » hors de ce type ; elle compte des
très gros plans sans résolution dans le montage ; des regards frontaux sans implication d’un destinataire
de la fiction et qui visent le spectatorat.
136 Installations / Boucles vidéos - Processus