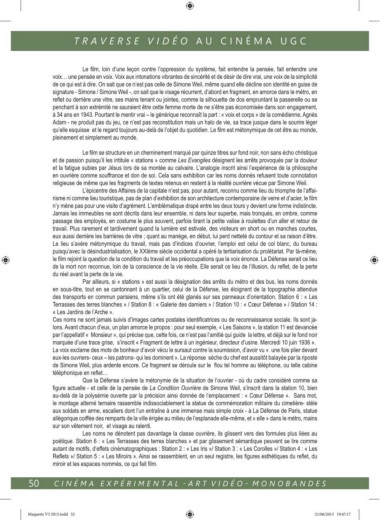Page 51 - catalogue_2015
P. 51
TRAVERSE VIDÉO AU CINÉMA UGC
Le film, loin d’une leçon contre l’oppression du système, fait entendre la pensée, fait entendre une
voix… une pensée en voix. Voix aux intonations vibrantes de sincérité et de désir de dire vrai, une voix de la simplicité
de ce qui est à dire. On sait que ce n’est pas celle de Simone Weil, même quand elle décline son identité en guise de
signature - Simone / Simone Weil -, on sait que le visage récurrent, d’abord en fragment, en amorce dans le métro, en
reflet ou derrière une vitre, ses mains tenant ou jointes, comme la silhouette de dos empruntant la passerelle ou se
penchant à son extrémité ne sauraient être cette femme morte de ne s’être pas économisée dans son engagement,
à 34 ans en 1943. Pourtant le mentir vrai – le générique reconnaît la part : « voix et corps » de la comédienne, Agnès
Adam - ne produit pas du jeu, ce n’est pas reconstitution mais un halo de vie, sa trace jusque dans le sourire léger
qu’elle esquisse et le regard toujours au-delà de l’objet du quotidien. Le film est métonymique de cet être au monde,
pleinement et simplement au monde.
Le film se structure en un cheminement marqué par quinze titres sur fond noir, non sans écho christique
et de passion puisqu’il les intitule « stations » comme Les Evangiles désignent les arrêts provoqués par la douleur
et la fatigue subies par Jésus lors de sa montée au calvaire. L’analogie inscrit ainsi l’expérience de la philosophe
en ouvrière comme souffrance et don de soi. Cela sans exhibition car les noms donnés refusent toute connotation
religieuse de même que les fragments de textes retenus en restent à la réalité ouvrière vécue par Simone Weil.
L’épicentre des Affaires de la capitale n’est pas, pour autant, reconnu comme lieu du triomphe de l’affai-
risme ni comme lieu touristique, pas de plan d’exhibition de son architecture contemporaine de verre et d’acier, le film
n’y mène pas pour une visite d’agrément. L’emblématique drapé entre les deux tours y devient une forme indistincte.
Jamais les immeubles ne sont décrits dans leur ensemble, ni dans leur superbe, mais tronqués, en ombre, comme
passage des employés, en costume le plus souvent, parfois tirant la petite valise à roulettes d’un aller et retour de
travail. Plus rarement et tardivement quand la lumière est estivale, des visiteurs en short ou en manches courtes,
eux aussi derrière les barrières de vitre ; quant au manège, en début, lui perd netteté du contour et sa raison d’être.
Le lieu s’avère métonymique du travail, mais pas d’indices d’ouvrier, l’emploi est celui de col blanc, du bureau
puisqu’avec la désindustrialisation, le XXIème siècle occidental a opéré la tertiarisation du prolétariat. Par là-même,
le film rejoint la question de la condition du travail et les préoccupations que la voix énonce. La Défense serait ce lieu
de la mort non reconnue, loin de la conscience de la vie réelle. Elle serait ce lieu de l’illusion, du reflet, de la perte
du réel avant la perte de la vie.
Par ailleurs, si « stations » est aussi la désignation des arrêts du métro et des bus, les noms donnés
en sous-titre, tout en se cantonnant à un quartier, celui de la Défense, les éloignent de la topographie attendue
des transports en commun parisiens, même s’ils ont été glanés sur ses panneaux d’orientation. Station 6 : « Les
Terrasses des terres blanches » / Station 8 : « Galerie des damiers » / Station 10 : « Cœur Défense » / Station 14 :
« Les Jardins de l’Arche ».
Ces noms ne sont jamais suivis d’images cartes postales identificatrices ou de reconnaissance sociale. Ils sont ja-
lons. Avant chacun d’eux, un plan amorce le propos : pour seul exemple, « Les Saisons », la station 11 est devancée
par l’appellatif « Monsieur », qui précise que, cette fois, ce n’est pas l’amitié qui guide la lettre, et déjà sur le fond noir
marquée d’une trace grise, s’inscrit « Fragment de lettre à un ingénieur, directeur d’usine. Mercredi 10 juin 1936 ».
La voix exclame des mots de bonheur d’avoir vécu le sursaut contre la soumission, d’avoir vu « une fois plier devant
eux-les ouvriers- ceux – les patrons- qui les dominent ». La réponse sèche du chef est aussitôt balayée par la riposte
de Simone Weil, plus ardente encore. Ce fragment se déroule sur le flou tel homme au téléphone, ou telle cabine
téléphonique en reflet…
Que la Défense s’avère la métonymie de la situation de l’ouvrier - où du cadre considéré comme sa
figure actuelle - et celle de la pensée de La Condition Ouvrière de Simone Weil, s’inscrit dans la station 10, bien
au-delà de la polysémie ouverte par la précision ainsi donnée de l’emplacement : « Cœur Défense ». Sans mot,
le montage alterné ternaire rassemble indissociablement la statue de commémoration militaire du cimetière- stèle
aux soldats en arme, escaliers dont l’un entraîne à une immense mais simple croix - à La Défense de Paris, statue
allégorique coiffée des remparts de la ville érigée au milieu de l’esplanade elle-même, et « elle » dans le métro, mains
sur son vêtement noir, et visage au ralenti.
Les noms ne dénotent pas davantage la classe ouvrière, ils glissent vers des formules plus liées au
poétique. Station 6 : « Les Terrasses des terres blanches » et par glissement sémantique peuvent se lire comme
autant de motifs, d’effets cinématographiques : Station 2 : « Les Iris »/ Station 3 : « Les Corolles »/ Station 4 : « Les
Reflets »/ Station 5 : « Les Miroirs ». Ainsi se rassemblent, en un seul registre, les figures esthétiques du reflet, du
miroir et les espaces nommés, ce qui fait film.
50 C I N É M A E X P É R I M E N T A L - A R T V I D É O - M O N O B A N D E S
Maquette V3 2015.indd 52 21/06/2015 19:47:17