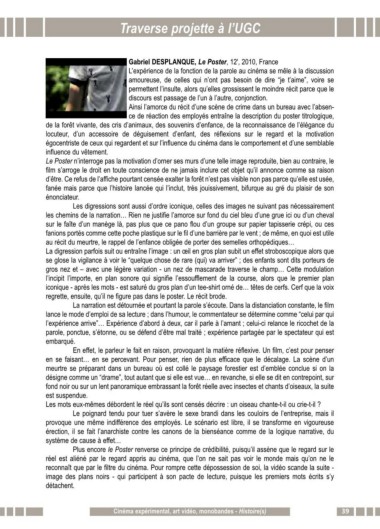Page 39 - catalogue_2013
P. 39
Traverse projette à l’UGC
Gabriel DESPLANQUE, Le Poster, 12', 2010, France
L’expérience de la fonction de la parole au cinéma se mêle à la discussion
amoureuse, de celles qui n’ont pas besoin de dire “je t’aime”, voire se
permettent l’insulte, alors qu’elles grossissent le moindre récit parce que le
discours est passage de l’un à l’autre, conjonction.
Ainsi l’amorce du récit d’une scène de crime dans un bureau avec l’absen-
ce de réaction des employés entraîne la description du poster titrologique,
de la forêt vivante, des cris d’animaux, des souvenirs d’enfance, de la reconnaissance de l’élégance du
locuteur, d’un accessoire de déguisement d’enfant, des réflexions sur le regard et la motivation
égocentriste de ceux qui regardent et sur l’influence du cinéma dans le comportement et d’une semblable
influence du vêtement.
Le Poster n’interroge pas la motivation d’orner ses murs d’une telle image reproduite, bien au contraire, le
film s’arroge le droit en toute conscience de ne jamais inclure cet objet qu’il annonce comme sa raison
d’être. Ce refus de l’affiche pourtant censée exalter la forêt n’est pas visible non pas parce qu’elle est usée,
fanée mais parce que l’histoire lancée qui l’inclut, très jouissivement, bifurque au gré du plaisir de son
énonciateur.
Les digressions sont aussi d’ordre iconique, celles des images ne suivant pas nécessairement
les chemins de la narration… Rien ne justifie l’amorce sur fond du ciel bleu d’une grue ici ou d’un cheval
sur le faîte d’un manège là, pas plus que ce pano flou d’un groupe sur papier tapisserie crépi, ou ces
fanions portés comme cette poche plastique sur le fil d’une barrière par le vent ; de même, en quoi est utile
au récit du meurtre, le rappel de l’enfance obligée de porter des semelles orthopédiques…
La digression parfois suit ou entraîne l’image : un œil en gros plan subit un effet stroboscopique alors que
se glose la vigilance à voir le “quelque chose de rare (qui) va arriver” ; des enfants sont dits porteurs de
gros nez et – avec une légère variation - un nez de mascarade traverse le champ… Cette modulation
l’incipit l’importe, en plan sonore qui signifie l’essoufflement de la course, alors que le premier plan
iconique - après les mots - est saturé du gros plan d’un tee-shirt orné de… têtes de cerfs. Cerf que la voix
regrette, ensuite, qu’il ne figure pas dans le poster. Le récit brode.
La narration est détournée et pourtant la parole s’écoute. Dans la distanciation constante, le film
lance le mode d’emploi de sa lecture ; dans l’humour, le commentateur se détermine comme “celui par qui
l’expérience arrive”… Expérience d’abord à deux, car il parle à l’amant ; celui-ci relance le ricochet de la
parole, ponctue, s’étonne, ou se défend d’être mal traité ; expérience partagée par le spectateur qui est
embarqué.
En effet, le parleur le fait en raison, provoquant la matière réflexive. Un film, c’est pour penser
en se faisant… en se percevant. Pour penser, rien de plus efficace que le décalage. La scène d’un
meurtre se préparant dans un bureau où est collé le paysage forestier est d’emblée conclue si on la
désigne comme un “drame”, tout autant que si elle est vue… en revanche, si elle se dit en contrepoint, sur
fond noir ou sur un lent panoramique embrassant la forêt réelle avec insectes et chants d’oiseaux, la suite
est suspendue.
Les mots eux-mêmes débordent le réel qu’ils sont censés décrire : un oiseau chante-t-il ou crie-t-il ?
Le poignard tendu pour tuer s’avère le sexe brandi dans les couloirs de l’entreprise, mais il
provoque une même indifférence des employés. Le scénario est libre, il se transforme en vigoureuse
érection, il se fait l’anarchiste contre les canons de la bienséance comme de la logique narrative, du
système de cause à effet…
Plus encore le Poster renverse ce principe de crédibilité, puisqu’il assène que le regard sur le
réel est aliéné par le regard appris au cinéma, que l’on ne sait pas voir le monde mais qu’on ne le
reconnaît que par le filtre du cinéma. Pour rompre cette dépossession de soi, la vidéo scande la suite -
image des plans noirs - qui participent à son pacte de lecture, puisque les premiers mots écrits s’y
détachent.
Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s) 39