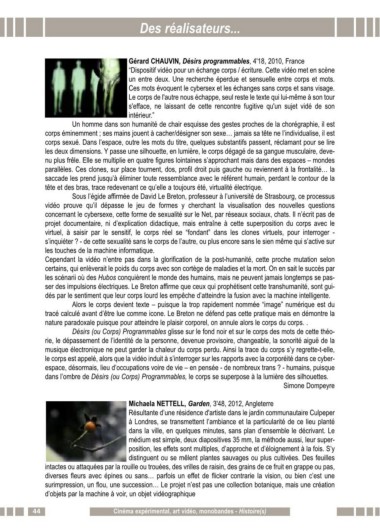Page 44 - catalogue_2013
P. 44
Des réalisateurs...
Gérard CHAUVIN, Désirs programmables, 4'18, 2010, France
“Dispositif vidéo pour un échange corps / écriture. Cette vidéo met en scène
un entre deux. Une recherche éperdue et sensuelle entre corps et mots.
Ces mots évoquent le cybersex et les échanges sans corps et sans visage.
Le corps de l'autre nous échappe, seul reste le texte qui lui-même à son tour
s'efface, ne laissant de cette rencontre fugitive qu'un sujet vidé de son
intérieur.”
Un homme dans son humanité de chair esquisse des gestes proches de la chorégraphie, il est
corps éminemment ; ses mains jouent à cacher/désigner son sexe… jamais sa tête ne l’individualise, il est
corps sexué. Dans l’espace, outre les mots du titre, quelques substantifs passent, réclamant pour se lire
les deux dimensions. Y passe une silhouette, en lumière, le corps dégagé de sa gangue musculaire, deve-
nu plus frêle. Elle se multiplie en quatre figures lointaines s’approchant mais dans des espaces – mondes
parallèles. Ces clones, sur place tournent, dos, profil droit puis gauche ou reviennent à la frontalité… la
saccade les prend jusqu’à éliminer toute ressemblance avec le référent humain, perdant le contour de la
tête et des bras, trace redevenant ce qu’elle a toujours été, virtualité électrique.
Sous l’égide affirmée de David Le Breton, professeur à l’université de Strasbourg, ce processus
vidéo prouve qu’il dépasse le jeu de formes y cherchant la visualisation des nouvelles questions
concernant le cybersexe, cette forme de sexualité sur le Net, par réseaux sociaux, chats. Il n’écrit pas de
projet documentaire, ni d’explication didactique, mais entraîne à cette superposition du corps avec le
virtuel, à saisir par le sensitif, le corps réel se “fondant” dans les clones virtuels, pour interroger -
s’inquiéter ? - de cette sexualité sans le corps de l’autre, ou plus encore sans le sien même qui s’active sur
les touches de la machine informatique.
Cependant la vidéo n’entre pas dans la glorification de la post-humanité, cette proche mutation selon
certains, qui enlèverait le poids du corps avec son cortège de maladies et la mort. On en sait le succès par
les scénarii où des Hubos conquièrent le monde des humains, mais ne peuvent jamais longtemps se pas-
ser des impulsions électriques. Le Breton affirme que ceux qui prophétisent cette transhumanité, sont gui-
dés par le sentiment que leur corps lourd les empêche d’atteindre la fusion avec la machine intelligente.
Alors le corps devient texte – puisque la trop rapidement nommée “image” numérique est du
tracé calculé avant d’être lue comme icone. Le Breton ne défend pas cette pratique mais en démontre la
nature paradoxale puisque pour atteindre le plaisir corporel, on annule alors le corps du corps. .
Désirs (ou Corps) Programmables glisse sur le fond noir et sur le corps des mots de cette théo-
rie, le dépassement de l’identité de la personne, devenue provisoire, changeable, la sonorité aiguë de la
musique électronique ne peut garder la chaleur du corps perdu. Ainsi la trace du corps s’y regrette-t-elle,
le corps est appelé, alors que la vidéo induit à s’interroger sur les rapports avec la corporéité dans ce cyber-
espace, désormais, lieu d’occupations voire de vie – en pensée - de nombreux trans ? - humains, puisque
dans l’ombre de Désirs (ou Corps) Programmables, le corps se superpose à la lumière des silhouettes.
Simone Dompeyre
Michaela NETTELL, Garden, 3'48, 2012, Angleterre
Résultante d’une résidence d'artiste dans le jardin communautaire Culpeper
à Londres, se transmettent l’ambiance et la particularité de ce lieu planté
dans la ville, en quelques minutes, sans plan d’ensemble le décrivant. Le
médium est simple, deux diapositives 35 mm, la méthode aussi, leur super-
position, les effets sont multiples, d’approche et d’éloignement à la fois. S’y
distinguent ou se mêlent plantes sauvages ou plus cultivées. Des feuilles
intactes ou attaquées par la rouille ou trouées, des vrilles de raisin, des grains de ce fruit en grappe ou pas,
diverses fleurs avec épines ou sans… parfois un effet de flicker contrarie la vision, ou bien c’est une
surimpression, un flou, une succession… Le projet n’est pas une collection botanique, mais une création
d’objets par la machine à voir, un objet vidéographique
44 Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s)