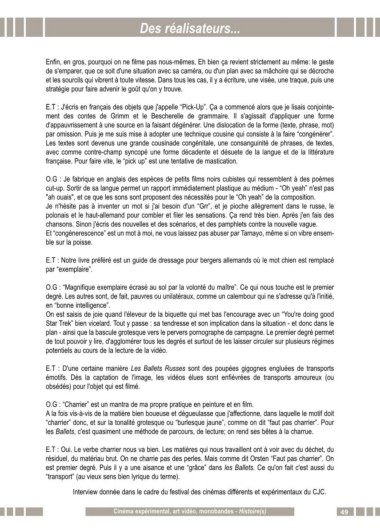Page 49 - catalogue_2013
P. 49
Des réalisateurs...
Enfin, en gros, pourquoi on ne filme pas nous-mêmes, Eh bien ça revient strictement au même: le geste
de s'emparer, que ce soit d'une situation avec sa caméra, ou d'un plan avec sa mâchoire qui se décroche
et les sourcils qui vibrent à toute vitesse. Dans tous les cas, il y a écriture, une visée, une traque, puis une
stratégie pour faire advenir le goût qu'on y trouve.
E.T : J'écris en français des objets que j'appelle “Pick-Up”. Ça a commencé alors que je lisais conjointe-
ment des contes de Grimm et le Bescherelle de grammaire. Il s'agissait d'appliquer une forme
d'appauvrissement à une source en la faisant dégénérer. Une dislocation de la forme (texte, phrase, mot)
par omission. Puis je me suis mise à adopter une technique cousine qui consiste à la faire “congénérer”.
Les textes sont devenus une grande cousinade congénitale, une consanguinité de phrases, de textes,
avec comme contre-champ syncopé une forme décadente et désuete de la langue et de la littérature
française. Pour faire vite, le “pick up” est une tentative de mastication.
O.G : Je fabrique en anglais des espèces de petits films noirs cubistes qui ressemblent à des poèmes
cut-up. Sortir de sa langue permet un rapport immédiatement plastique au médium - “Oh yeah” n'est pas
"ah ouais", et ce que les sons sont proposent des nécessités pour le “Oh yeah” de la composition.
Je n'hésite pas à inventer un mot si j'ai besoin d'un “Grr”, et je pioche allègrement dans le russe, le
polonais et le haut-allemand pour combler et filer les sensations. Ça rend très bien. Après j'en fais des
chansons. Sinon j'écris des nouvelles et des scénarios, et des pamphlets contre la nouvelle vague.
Et “congénerescence” est un mot à moi, ne vous laissez pas abuser par Tamayo, même si on vibre ensem-
ble sur la poisse.
E.T : Notre livre préféré est un guide de dressage pour bergers allemands où le mot chien est remplacé
par “exemplaire”.
O.G : “Magnifique exemplaire écrasé au sol par la volonté du maître”. Ce qui nous touche est le premier
degré. Les autres sont, de fait, pauvres ou unilatéraux, comme un calembour qui ne s'adresse qu'à l'initié,
en “bonne intelligence”.
On est saisis de joie quand l'éleveur de la biquette qui met bas l'encourage avec un “You're doing good
Star Trek” bien vicelard. Tout y passe : sa tendresse et son implication dans la situation - et donc dans le
plan - ainsi que la bascule grotesque vers le pervers pornographe de campagne. Le premier degré permet
de tout pouvoir y lire, d'agglomérer tous les degrés et surtout de les laisser circuler sur plusieurs régimes
potentiels au cours de la lecture de la vidéo.
E.T : D'une certaine manière Les Ballets Russes sont des poupées gigognes engluées de transports
émotifs. Dès la captation de l'image, les vidéos élues sont enfiévrées de transports amoureux (ou
obsédés) pour l'objet qui est filmé.
O.G : “Charrier” est un mantra de ma propre pratique en peinture et en film.
A la fois vis-à-vis de la matière bien boueuse et dégueulasse que j'affectionne, dans laquelle le motif doit
“charrier” donc, et sur la tonalité grotesque ou “burlesque jaune”, comme on dit “faut pas charrier”. Pour
les Ballets, c'est quasiment une méthode de parcours, de lecture; on rend ses bêtes à la charrue.
E.T : Oui. Le verbe charrier nous va bien. Les matières qui nous travaillent ont à voir avec du déchet, du
résiduel, du matériau brut. On ne charrie pas des perles. Mais comme dit Orsten “Faut pas charrier”. On
est premier degré. Puis il y a une aisance et une “grâce” dans les Ballets. Ce qu'on fait c'est aussi du
“transport” (au vieux sens bien lyrique du terme).
Interview donnée dans le cadre du festival des cinémas différents et expérimentaux du CJC.
Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s) 49