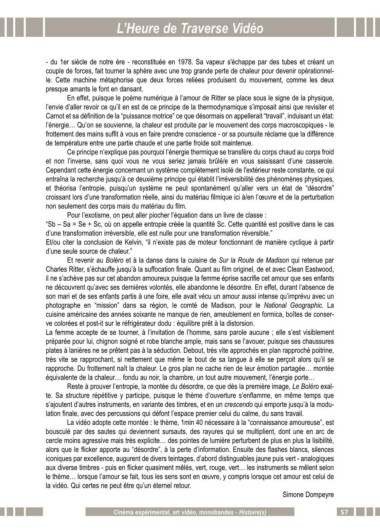Page 57 - catalogue_2013
P. 57
L’Heure de Traverse Vidéo
- du 1er siècle de notre ère - reconstituée en 1978. Sa vapeur s'échappe par des tubes et créant un
couple de forces, fait tourner la sphère avec une trop grande perte de chaleur pour devenir opérationnel-
le. Cette machine métaphorise que deux forces reliées produisent du mouvement, comme les deux
presque amants le font en dansant.
En effet, puisque le poème numérique à l’amour de Ritter se place sous le signe de la physique,
l’envie d’aller revoir ce qu’il en est de ce principe de la thermodynamique s’imposait ainsi que revisiter et
Carnot et sa définition de la “puissance motrice” ce que désormais on appellerait “travail”, induisant un état:
l’énergie… Qu’on se souvienne, la chaleur est produite par le mouvement des corps macroscopiques - le
frottement des mains suffit à vous en faire prendre conscience - or sa poursuite réclame que la différence
de température entre une partie chaude et une partie froide soit maintenue.
Ce principe n’explique pas pourquoi l’énergie thermique se transfère du corps chaud au corps froid
et non l’inverse, sans quoi vous ne vous seriez jamais brûlé/e en vous saisissant d’une casserole.
Cependant cette énergie concernant un système complètement isolé de l'extérieur reste constante, ce qui
entraîna la recherche jusqu’à ce deuxième principe qui établit l’irréversibilité des phénomènes physiques,
et théorisa l’entropie, puisqu’un système ne peut spontanément qu’aller vers un état de “désordre”
croissant lors d’une transformation réelle, ainsi du matériau filmique ici à/en l’œuvre et de la perturbation
non seulement des corps mais du matériau du film.
Pour l’exotisme, on peut aller piocher l’équation dans un livre de classe :
“Sb – Sa = Se + Sc, où on appelle entropie créée la quantité Sc. Cette quantité est positive dans le cas
d’une transformation irréversible, elle est nulle pour une transformation réversible.”
Et/ou citer la conclusion de Kelvin, “il n’existe pas de moteur fonctionnant de manière cyclique à partir
d’une seule source de chaleur.”
Et revenir au Boléro et à la danse dans la cuisine de Sur la Route de Madison qui retenue par
Charles Ritter, s’échauffe jusqu’à la suffocation finale. Quant au film originel, de et avec Clean Eastwood,
il ne s’achève pas sur cet abandon amoureux puisque la femme éprise sacrifie cet amour que ses enfants
ne découvrent qu’avec ses dernières volontés, elle abandonne le désordre. En effet, durant l’absence de
son mari et de ses enfants partis à une foire, elle avait vécu un amour aussi intense qu’imprévu avec un
photographe en “mission” dans sa région, le comté de Madison, pour le National Geographic. La
cuisine américaine des années soixante ne manque de rien, ameublement en formica, boîtes de conser-
ve colorées et post-it sur le réfrigérateur dodu : équilibre prêt à la distorsion.
La femme accepte de se tourner, à l’invitation de l’homme, sans parole aucune ; elle s’est visiblement
préparée pour lui, chignon soigné et robe blanche ample, mais sans se l’avouer, puisque ses chaussures
plates à lanières ne se prêtent pas à la séduction. Debout, très vite approchés en plan rapproché poitrine,
très vite se rapprochant, si nettement que même le bout de sa langue à elle se perçoit alors qu’il se
rapproche. Du frottement naît la chaleur. Le gros plan ne cache rien de leur émotion partagée… montée
équivalente de la chaleur… fondu au noir, la chambre, un tout autre mouvement, l’énergie porte…
Reste à prouver l’entropie, la montée du désordre, ce que dès la première image, Le Boléro exal-
te. Sa structure répétitive y participe, puisque le thème d’ouverture s’enflamme, en même temps que
s’ajoutent d’autres instruments, en variante des timbres, et en un crescendo qui emporte jusqu’à la modu-
lation finale, avec des percussions qui défont l’espace premier celui du calme, du sans travail.
La vidéo adopte cette montée : le thème, 1min 40 nécessaire à la “connaissance amoureuse”, est
bousculé par des sautes qui deviennent sursauts, des rayures qui se multiplient, dont une en arc de
cercle moins agressive mais très explicite… des pointes de lumière perturbent de plus en plus la lisibilité,
alors que le flicker apporte au “désordre”, à la perte d’information. Ensuite des flashes blancs, silences
iconiques par excellence, augurent de divers teintages, d’abord distinguables jaune puis vert - analogiques
aux diverse timbres - puis en flicker quasiment mêlés, vert, rouge, vert… les instruments se mêlent selon
le thème… lorsque l’amour se fait, tous les sens sont en œuvre, y compris lorsque cet amour est celui de
la vidéo. Qui certes ne peut être qu’un éternel retour.
Simone Dompeyre
Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s) 57