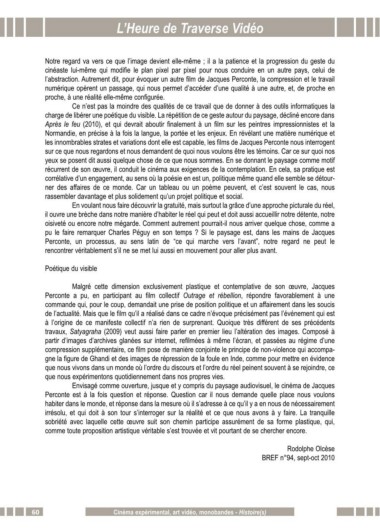Page 60 - catalogue_2013
P. 60
L’Heure de Traverse Vidéo
Notre regard va vers ce que l’image devient elle-même ; il a la patience et la progression du geste du
cinéaste lui-même qui modifie le plan pixel par pixel pour nous conduire en un autre pays, celui de
l’abstraction. Autrement dit, pour évoquer un autre film de Jacques Perconte, la compression et le travail
numérique opèrent un passage, qui nous permet d’accéder d’une qualité à une autre, et, de proche en
proche, à une réalité elle-même configurée.
Ce n’est pas la moindre des qualités de ce travail que de donner à des outils informatiques la
charge de libérer une poétique du visible. La répétition de ce geste autour du paysage, décliné encore dans
Après le feu (2010), et qui devrait aboutir finalement à un film sur les peintres impressionnistes et la
Normandie, en précise à la fois la langue, la portée et les enjeux. En révélant une matière numérique et
les innombrables strates et variations dont elle est capable, les films de Jacques Perconte nous interrogent
sur ce que nous regardons et nous demandent de quoi nous voulons être les témoins. Car ce sur quoi nos
yeux se posent dit aussi quelque chose de ce que nous sommes. En se donnant le paysage comme motif
récurrent de son œuvre, il conduit le cinéma aux exigences de la contemplation. En cela, sa pratique est
corrélative d’un engagement, au sens où la poésie en est un, politique même quand elle semble se détour-
ner des affaires de ce monde. Car un tableau ou un poème peuvent, et c’est souvent le cas, nous
rassembler davantage et plus solidement qu’un projet politique et social.
En voulant nous faire découvrir la gratuité, mais surtout la grâce d’une approche picturale du réel,
il ouvre une brèche dans notre manière d’habiter le réel qui peut et doit aussi accueillir notre détente, notre
oisiveté ou encore notre mégarde. Comment autrement pourrait-il nous arriver quelque chose, comme a
pu le faire remarquer Charles Péguy en son temps ? Si le paysage est, dans les mains de Jacques
Perconte, un processus, au sens latin de “ce qui marche vers l’avant”, notre regard ne peut le
rencontrer véritablement s’il ne se met lui aussi en mouvement pour aller plus avant.
Poétique du visible
Malgré cette dimension exclusivement plastique et contemplative de son œuvre, Jacques
Perconte a pu, en participant au film collectif Outrage et rébellion, répondre favorablement à une
commande qui, pour le coup, demandait une prise de position politique et un affairement dans les soucis
de l’actualité. Mais que le film qu’il a réalisé dans ce cadre n’évoque précisément pas l’événement qui est
à l’origine de ce manifeste collectif n’a rien de surprenant. Quoique très différent de ses précédents
travaux, Satyagraha (2009) veut aussi faire parler en premier lieu l’altération des images. Composé à
partir d’images d’archives glanées sur internet, refilmées à même l’écran, et passées au régime d’une
compression supplémentaire, ce film pose de manière conjointe le principe de non-violence qui accompa-
gne la figure de Ghandi et des images de répression de la foule en Inde, comme pour mettre en évidence
que nous vivons dans un monde où l’ordre du discours et l’ordre du réel peinent souvent à se rejoindre, ce
que nous expérimentons quotidiennement dans nos propres vies.
Envisagé comme ouverture, jusque et y compris du paysage audiovisuel, le cinéma de Jacques
Perconte est à la fois question et réponse. Question car il nous demande quelle place nous voulons
habiter dans le monde, et réponse dans la mesure où il s’adresse à ce qu’il y a en nous de nécessairement
irrésolu, et qui doit à son tour s’interroger sur la réalité et ce que nous avons à y faire. La tranquille
sobriété avec laquelle cette œuvre suit son chemin participe assurément de sa forme plastique, qui,
comme toute proposition artistique véritable s’est trouvée et vit pourtant de se chercher encore.
Rodolphe Olcèse
BREF n°94, sept-oct 2010
60 Cinéma expérimental, art vidéo, monobandes - Histoire(s)