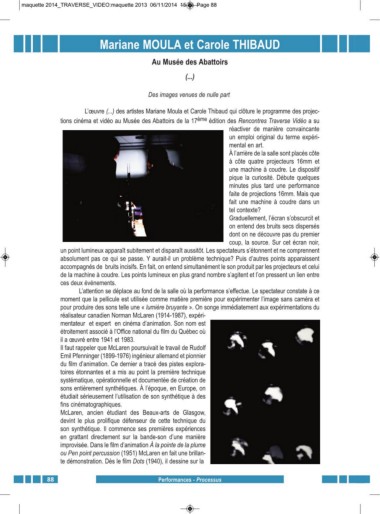Page 89 - catalogue_2014
P. 89
maquette 2014_TRAVERSE_VIDEO:maquette 2013 06/11/2014 15:53 Page 88
Mariane MOULA et Carole THIBAUD
Au Musée des Abattoirs
(...)
Des images venues de nulle part
L’œuvre (...) des artistes Mariane Moula et Carole Thibaud qui clôture le programme des projec-
tions cinéma et vidéo au Musée des Abattoirs de la 17ème édition des Rencontres Traverse Vidéo a su
réactiver de manière convaincante
un emploi original du terme expéri-
mental en art.
À l’arrière de la salle sont placés côte
à côte quatre projecteurs 16mm et
une machine à coudre. Le dispositif
pique la curiosité. Débute quelques
minutes plus tard une performance
faite de projections 16mm. Mais que
fait une machine à coudre dans un
tel contexte?
Graduellement, l’écran s’obscurcit et
on entend des bruits secs dispersés
dont on ne découvre pas du premier
coup, la source. Sur cet écran noir,
un point lumineux apparaît subitement et disparaît aussitôt. Les spectateurs s’étonnent et ne comprennent
absolument pas ce qui se passe. Y aurait-il un problème technique? Puis d’autres points apparaissent
accompagnés de bruits incisifs. En fait, on entend simultanément le son produit par les projecteurs et celui
de la machine à coudre. Les points lumineux en plus grand nombre s’agitent et l’on pressent un lien entre
ces deux événements.
L’attention se déplace au fond de la salle où la performance s’effectue. Le spectateur constate à ce
moment que la pellicule est utilisée comme matière première pour expérimenter l’image sans caméra et
pour produire des sons telle une « lumière bruyante ». On songe immédiatement aux expérimentations du
réalisateur canadien Norman McLaren (1914-1987), expéri-
mentateur et expert en cinéma d’animation. Son nom est
étroitement associé à l’Office national du film du Québec où
il a œuvré entre 1941 et 1983.
Il faut rappeler que McLaren poursuivait le travail de Rudolf
Emil Pfenninger (1899-1976) ingénieur allemand et pionnier
du film d’animation. Ce dernier a tracé des pistes explora-
toires étonnantes et a mis au point la première technique
systématique, opérationnelle et documentée de création de
sons entièrement synthétiques. À l’époque, en Europe, on
étudiait sérieusement l’utilisation de son synthétique à des
fins cinématographiques.
McLaren, ancien étudiant des Beaux-arts de Glasgow,
devint le plus prolifique défenseur de cette technique du
son synthétique. Il commence ses premières expériences
en grattant directement sur la bande-son d’une manière
improvisée. Dans le film d’animation À la pointe de la plume
ou Pen point percussion (1951) McLaren en fait une brillan-
te démonstration. Dès le film Dots (1940), il dessine sur la
88 Performances - Processus