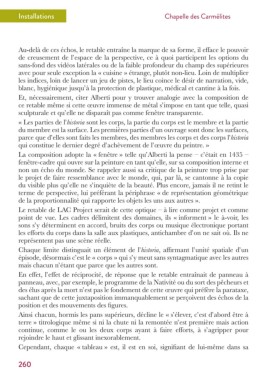Page 260 - Catalogue-livre_Rencontres Traverse 2019_L'Expérimental-recherche-art
P. 260
Installations Chapelle des Carmélites
Au-delà de ces échos, le retable entraîne la marque de sa forme, il efface le pouvoir
de creusement de l’espace de la perspective, ce à quoi participent les options du
sans-fond des vidéos latérales ou de la faible profondeur du champ des supérieures
avec pour seule exception la « cuisine » étrange, plutôt non-lieu. Loin de multiplier
les indices, loin de lancer un jeu de pistes, le lieu coince le désir de narration, vide,
blanc, hygiénique jusqu’à la protection de plastique, médical et cantine à la fois.
Et, nécessairement, citer Alberti pour y trouver analogie avec la composition de
ce retable même si cette œuvre immense de métal s’impose en tant que telle, quasi
sculpturale et qu’elle ne disparaît pas comme fenêtre transparente.
« Les parties de l’historia sont les corps, la partie du corps est le membre et la partie
du membre est la surface. Les premières parties d’un ouvrage sont donc les surfaces,
parce que d’elles sont faits les membres, des membres les corps et des corps l’historia
qui constitue le dernier degré d’achèvement de l’œuvre du peintre. »
La composition adopte la « fenêtre » telle qu’Alberti la pense – c’était en 1435 –
fenêtre-cadre qui ouvre sur la peinture en tant qu’elle, sur sa composition interne et
non un écho du monde. Se rappeler aussi sa critique de la peinture trop prise par
le projet de faire ressemblance avec le monde, qui, par là, se cantonne à la copie
du visible plus qu’elle ne s’inquiète de la beauté. Plus encore, jamais il ne retint le
terme de perspective, lui préférant la périphrase « de représentation géométrique
de la proportionnalité qui rapporte les objets les uns aux autres ».
Le retable de LAC Project serait de cette optique – à lire comme projet et comme
point de vue. Les cadres délimitent des domaines, ils « informent » le à-voir, les
sons s’y déterminent en accord, bruits des corps ou musique électronique portant
les efforts du corps dans la salle aux plastiques, antichambre d’on ne sait où. Ils ne
représentent pas une scène réelle.
Chaque limite distinguait un élément de l’historia, affirmant l’unité spatiale d’un
épisode, désormais c’est le « corps » qui s’y meut sans syntagmatique avec les autres
mais chacun n’étant que parce que les autres sont.
En effet, l’effet de réciprocité, de réponse que le retable entraînait de panneau à
panneau, avec, par exemple, le programme de la Nativité ou du sort des pêcheurs et
des élus après la mort n’est pas le fondement de cette œuvre qui préfère la parataxe,
sachant que de cette juxtaposition immanquablement se perçoivent des échos de la
position et des mouvements des figures.
Ainsi chacun, hormis les pans supérieurs, décline le « s’élever, c’est d’abord être à
terre » titrologique même si ni la chute ni la remontée n’est première mais action
continue, comme le ou les deux corps ayant à faire efforts, à s’agripper pour
rejoindre le haut et glissant inexorablement.
Cependant, chaque « tableau » est, il est en soi, signifiant de lui-même dans sa
260