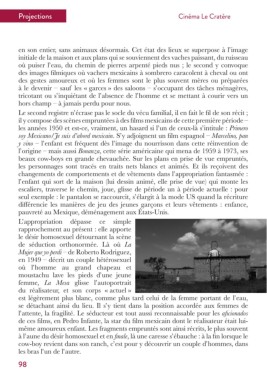Page 98 - Catalogue-livre_Rencontres Traverse 2019_L'Expérimental-recherche-art
P. 98
Projections Cinéma Le Cratère
en son entier, sans animaux désormais. Cet état des lieux se superpose à l’image
initiale de la maison et aux plans qui se souviennent des vaches paissant, du ruisseau
où puiser l’eau, du chemin de pierres arpenté pieds nus ; le second y convoque
des images filmiques où vachers mexicains à sombrero caracolent à cheval ou ont
des gestes amoureux et où les femmes sont le plus souvent mères ou préparées
à le devenir – sauf les « garces » des saloons – s’occupant des tâches ménagères,
tricotant ou s’inquiétant de l’absence de l’homme et se mettant à courir vers un
hors champ – à jamais perdu pour nous.
Le second registre n’écrase pas le socle du vécu familial, il en fait le fil de son récit ;
il y compose des scènes empruntées à des films mexicains de cette première période –
les années 1950 et est-ce, vraiment, un hasard si l’un de ceux-là s’intitule : Primero
soy Mexicano/Je suis d’abord mexicain. S’y adjoignent un film espagnol – Marcelino, pan
y vino – l’enfant est fréquent dès l’image du nourrisson dans cette réinvention de
l’origine – mais aussi Bonanza, cette série américaine qui mena de 1959 à 1973, ses
beaux cow-boys en grande chevauchée. Sur les plans en prise de vue empruntés,
les personnages sont tracés en traits nets blancs et animés. Et ils reçoivent des
changements de comportements et de vêtements dans l’appropriation fantasmée :
l’enfant qui sort de la maison (lui dessin animé, elle prise de vue) qui monte les
escaliers, traverse le chemin, joue, glisse de période un à période actuelle : pour
seul exemple : le pantalon se raccourcit, s’élargit à la mode US quand la récriture
différencie les manières de jeu des jeunes garçons et leurs vêtements : enfance,
pauvreté au Mexique, déménagement aux États-Unis.
L’appropriation dépasse ce simple
rapprochement au présent : elle apporte
le désir homosexuel détournant la scène
de séduction orthonormée. Là où La
Mujer que yo perdi – de Roberto Rodriguez,
en 1949 – décrit un couple hétérosexuel
où l’homme au grand chapeau et
moustachu lave les pieds d’une jeune
femme, La Mesa glisse l’autoportrait
du réalisateur, et son corps « actuel »
est légèrement plus blanc, comme plus tard celui de la femme portant de l’eau,
se détachant ainsi du lieu. Il s’y tient dans la position accordée aux femmes de
l’attente, la fragilité. Le séducteur est tout aussi reconnaissable pour les aficionados
de ces films, en Pedro Infante, la star du film mexicain dont le réalisateur était lui-
même amoureux enfant. Les fragments empruntés sont ainsi récrits, le plus souvent
à l’aune du désir homosexuel et en finale, là une caresse s’ébauche : à la fin lorsque le
cow-boy revient dans son ranch, c’est pour y découvrir un couple d’hommes, dans
les bras l’un de l’autre.
98